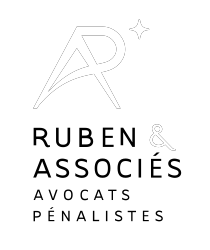Actualité juridique pénale
Tribune : « J’étais directrice pénitentiaire d’insertion et de probation, j’ai démissionné. Voilà pourquoi »
Lasse d’être maltraitée, de voir ses collègues enchaîner les burn-out et parfois même les suicides, Manon (le prénom a été modifié) a quitté son poste qu’elle n’a pourtant jamais cessé d’aimer.
« Fiers de servir la Justice » : tel est le slogan des campagnes de recrutement de l’administration pénitentiaire (« l’AP » dans notre jargon). Mais quelle fierté peut-on trouver à être méprisé ? Peut-on réellement parler de « servir la Justice » lorsque les moyens humains et financiers accordés à la lutte contre la récidive sont dérisoires ?
Directrice pénitentiaire d’insertion et de probation. Voilà le métier que j’ai exercé une dizaine d’années dans différentes prisons. Cela consistait à « manager » l’ensemble des personnels du SPIP : le service pénitentiaire d’insertion et de probation.
Ce service qui a pour mission première de lutter contre la récidive est ainsi chargé d’accompagner les personnes détenues dans leur parcours d’exécution de peine et de préparer leur sortie de détention pour favoriser leur réinsertion. Tout cela, dans des conditions humaines et financières complètement inadaptées.
« J’adore mon métier, mais je déteste les conditions dans lesquelles on me met pour l’exercer. » C’est la phrase que je répétais sans cesse lorsqu’on me demandait comment je vivais le fait de travailler en milieu carcéral. Cette même phrase, je l’ai prononcée il y a plusieurs mois à une psychologue du travail, épuisée, écœurée de tenter de travailler en cohérence dans une administration qui ne l’est pas. Cette phrase, je ne la prononcerai plus car j’ai cessé d’exercer ce métier.
Ce poste était passionnant, captivant et surtout enrichissant : riche de diversité, de projets, de partenariats, de solidarité, de créativité. Mais c’était aussi un métier épuisant, éreintant, soumis quotidiennement à des injonctions paradoxales.
Les prisons françaises souffrent d’un manque criant de ressources humaines, dans un contexte de surpopulation carcérale.
J’étais soumise à des demandes hiérarchiques incessantes, innombrables, systématiquement urgentes et totalement déconnectées des réalités de terrain, et à une utilisation uniquement politisée des crédits alloués.
De monstrueuses sommes sont par exemple dépensées dans le cadre de la lutte contre la radicalisation : 15 000 euros pour des programmes de prévention de la radicalisation ne concernant que cinq à dix détenus.
Tandis que les moyens accordés à la recherche de solution d’hébergement à la sortie sont dérisoires, nous amenant parfois à placer à l’hôtel des personnes en fin de peine à fort taux de récidive. Celles-ci, qui payent leurs nuits avec leurs maigres deniers, se retrouvent donc rapidement à la rue, représentent un risque de dangerosité, et ne tardent parfois pas à récidiver.
Alors on se démène, on tente de résister, on s’acharne à redonner du sens à des demandes qui n’en ont pas, en vain. On travaille d’arrache-pied et on ne compte plus les heures passées au bureau ou sur son ordinateur portable, soirs et week-ends compris.
En plus d’être sursollicitant pour le corps et l’esprit, ce métier est sous-rémunéré : les salaires sont dérisoires au vu du nombre d’heures effectuées, du niveau de responsabilité que requiert le poste, et la grille d’évolution de carrière est peu réjouissante et ce, comparé à des métiers similaires tels que directeur d’établissement médico-social. Et surtout, c’est un métier soumis à un manque total de reconnaissance.
Date: 29 mai 2020
Titre: L’Obs
Auteur: —–
Photo: Flickr/Poirpom/CC
Catégorie: Actualité juridique pénale